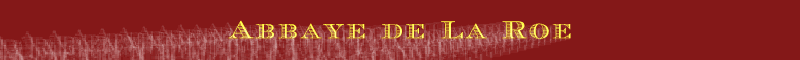


![]() our mettre comble à ces maux une famine épouvantable, cause ou effet de ces brigandages, dévasta le pays de 1146 à 1151 : - c’est elle sans doute qui réduisit tant de personnes à ces extrémités. Bodin assure que l’on vit même des malheureux réduits à manger de la chair humaine.
our mettre comble à ces maux une famine épouvantable, cause ou effet de ces brigandages, dévasta le pays de 1146 à 1151 : - c’est elle sans doute qui réduisit tant de personnes à ces extrémités. Bodin assure que l’on vit même des malheureux réduits à manger de la chair humaine.
![]() ans la suite des temps, lorsque la paix revint enfin avec le bon ordre, les immenses terres reçues par les couvents acquirent une valeur d’autant plus grande, qu’il n’y avait que les religieux à pouvoir cultiver en sûreté. Mais l’esprit civilisateur, dont chaque maison monastique était un foyer, ne se bornait pas au défrichement des terres, à apaiser les guerres, à arrêter des représailles par de pieuses fondations qui, souvent, forcèrent deux ennemis à venir prier sur le même tombeau ; on le vit aussi, comme dans notre abbaye, fonder des écoles pour la jeunesse et des hôpitaux où étaient soignées les maladies les plus dangereuses, telles que la lèpre.
ans la suite des temps, lorsque la paix revint enfin avec le bon ordre, les immenses terres reçues par les couvents acquirent une valeur d’autant plus grande, qu’il n’y avait que les religieux à pouvoir cultiver en sûreté. Mais l’esprit civilisateur, dont chaque maison monastique était un foyer, ne se bornait pas au défrichement des terres, à apaiser les guerres, à arrêter des représailles par de pieuses fondations qui, souvent, forcèrent deux ennemis à venir prier sur le même tombeau ; on le vit aussi, comme dans notre abbaye, fonder des écoles pour la jeunesse et des hôpitaux où étaient soignées les maladies les plus dangereuses, telles que la lèpre.
![]() ée sur les terres de seigneurs de Craon, grandie à l’ombre de la puissance de ces châtelains, l’abbaye de
La Roe
jouait vis-à-vis d’eux un grand rôle, à peu près similaire de l’abbaye de Clermont, vis-à-vis des seigneurs de Laval. Souvent ses abbés étaient appelés dans leurs conseils, souvent ils figuraient dans les cérémonies passées au sein de leur famille. Par contre, souvent aussi l’abbaye recevait la pieuse visite des ces protecteurs. – L’un d ‘eux, Hugues, l’honora en la choisissant comme lieu de dernier repos de deux de ses fils. – Deux barons, Maurice III et Amauri Ier, voulurent eux-mêmes y recevoir la sépulture.
ée sur les terres de seigneurs de Craon, grandie à l’ombre de la puissance de ces châtelains, l’abbaye de
La Roe
jouait vis-à-vis d’eux un grand rôle, à peu près similaire de l’abbaye de Clermont, vis-à-vis des seigneurs de Laval. Souvent ses abbés étaient appelés dans leurs conseils, souvent ils figuraient dans les cérémonies passées au sein de leur famille. Par contre, souvent aussi l’abbaye recevait la pieuse visite des ces protecteurs. – L’un d ‘eux, Hugues, l’honora en la choisissant comme lieu de dernier repos de deux de ses fils. – Deux barons, Maurice III et Amauri Ier, voulurent eux-mêmes y recevoir la sépulture.
![]() l semble que depuis la fin du XIIIème
siècle, les seigneurs de Craon se soient bien moins occupés de l’abbaye. Leur faveur s’était plutôt accumulés sur les établissements situés au centre même de leur puissance et surtout sur les chanoines de Saint-Nicolas. Comme lieu de sépulture ils choisirent l’église des Cordeliers d’Angers où Maurice VI, décédé en 1292, fit bâtir une chapelle à cet effet.
l semble que depuis la fin du XIIIème
siècle, les seigneurs de Craon se soient bien moins occupés de l’abbaye. Leur faveur s’était plutôt accumulés sur les établissements situés au centre même de leur puissance et surtout sur les chanoines de Saint-Nicolas. Comme lieu de sépulture ils choisirent l’église des Cordeliers d’Angers où Maurice VI, décédé en 1292, fit bâtir une chapelle à cet effet.


![]() ers la même époque, l’église de
La Roe
s’accrut d’un chœur dont on voit encore quelques restes. Sa riche et svelte architecture ogivale du XVe
siècle, devait peu s’harmoniser avec le style roman si grave du reste de l’édifice.
ers la même époque, l’église de
La Roe
s’accrut d’un chœur dont on voit encore quelques restes. Sa riche et svelte architecture ogivale du XVe
siècle, devait peu s’harmoniser avec le style roman si grave du reste de l’édifice.
![]() ’abbaye fut pillée plusieurs fois pendant les guerres de la Ligue : une note ajoutée au Cartulaire de La Roë, nous apprend qu’elle fut saccagée d’abord en 1562 par les huguenots, commandés par la Trémouille, puis en 1592 par les troupes du roi.
’abbaye fut pillée plusieurs fois pendant les guerres de la Ligue : une note ajoutée au Cartulaire de La Roë, nous apprend qu’elle fut saccagée d’abord en 1562 par les huguenots, commandés par la Trémouille, puis en 1592 par les troupes du roi.
![]() ais ces déprédations ne l’appauvrirent guère. Les terres, les bois, les métairies, les moulins, les dîmes, les rentes étaient valeurs qui n’atteignait point un coup de main. Aussi déjà depuis du temps, riche proie à saisir, importante récompense pour un serviteur dévoué, l’abbaye était-elle tombée aux mains royales, pour être mise en
commende, cet usage toujours défendu, toujours toléré, abus si fécond en avantage, avantage si fécond en abus. – Chacun sait qu’une abbaye en commende était celle où le roi nommait comme abbé un ecclésiastique séculier qui, généralement, jouissait en vertu de cette faveur d’un tiers du revenu, sans aucune autre obligation que d’en faire un bon usage. Il n’était point tenu de résider dans l’abbaye, ni à suivre la règle monachale ou canoniale ; - des deux autres tiers, l’un servait à faire vivre les religieux, l’autre devait être employé aux réparations de l’église et aux aumônes.
ais ces déprédations ne l’appauvrirent guère. Les terres, les bois, les métairies, les moulins, les dîmes, les rentes étaient valeurs qui n’atteignait point un coup de main. Aussi déjà depuis du temps, riche proie à saisir, importante récompense pour un serviteur dévoué, l’abbaye était-elle tombée aux mains royales, pour être mise en
commende, cet usage toujours défendu, toujours toléré, abus si fécond en avantage, avantage si fécond en abus. – Chacun sait qu’une abbaye en commende était celle où le roi nommait comme abbé un ecclésiastique séculier qui, généralement, jouissait en vertu de cette faveur d’un tiers du revenu, sans aucune autre obligation que d’en faire un bon usage. Il n’était point tenu de résider dans l’abbaye, ni à suivre la règle monachale ou canoniale ; - des deux autres tiers, l’un servait à faire vivre les religieux, l’autre devait être employé aux réparations de l’église et aux aumônes.
![]() e premier abbé commenditaire de
La Roe
fut, croyons nous, Etienne
Duporcher, évêque de Bayonne, et abbé de
La Roe
, en 1532, il eut pour successeur le cardinal d’
Armagnac. Bientôt après (1562), nous trouvons François de
Pisseleu
– c’était sans doute un frère de la célèbre duchesse d’Etampes, Anne de Pisseleu, maîtresse de François Ier. – Nous lisons en effet, dans le père Anselme, qu’elle
avança ses frères et sœurs, et Dieu sait qu’elle eut à faire et que toute la faveur du roi-chevalier n’y fut pas de trop, car ses frères et sœurs étaient au nombre de vingt-neuf. Lancelot de
Carle, Guy de
Lansac, Jean
Froger
et Jean
Rousseau, succédèrent à François de Pisseleu. – Le cardinal de
Sourdis
était abbé en 1600, lorsque survint à Notre-Dame de
La Roe
un grave changement. Elle subit alors en effet une première tentative de réforme, dont l’acte conservé au bureau des contrôleurs de Craon est de juin 1600.
e premier abbé commenditaire de
La Roe
fut, croyons nous, Etienne
Duporcher, évêque de Bayonne, et abbé de
La Roe
, en 1532, il eut pour successeur le cardinal d’
Armagnac. Bientôt après (1562), nous trouvons François de
Pisseleu
– c’était sans doute un frère de la célèbre duchesse d’Etampes, Anne de Pisseleu, maîtresse de François Ier. – Nous lisons en effet, dans le père Anselme, qu’elle
avança ses frères et sœurs, et Dieu sait qu’elle eut à faire et que toute la faveur du roi-chevalier n’y fut pas de trop, car ses frères et sœurs étaient au nombre de vingt-neuf. Lancelot de
Carle, Guy de
Lansac, Jean
Froger
et Jean
Rousseau, succédèrent à François de Pisseleu. – Le cardinal de
Sourdis
était abbé en 1600, lorsque survint à Notre-Dame de
La Roe
un grave changement. Elle subit alors en effet une première tentative de réforme, dont l’acte conservé au bureau des contrôleurs de Craon est de juin 1600.
![]() ers la fin du XVIe
siècle, les abbayes, et cela se comprend à la suite de si profonds troubles civils et religieux, les abbayes ne donnaient par les désordres qui y régnaient qu’un trop plausible prétexte aux déclamations anti-papistes des huguenots. Aussi, la nécessité d’une réforme radicale dans le clergé et surtout dans les établissements religieux se faisait-elle généralement sentir.
ers la fin du XVIe
siècle, les abbayes, et cela se comprend à la suite de si profonds troubles civils et religieux, les abbayes ne donnaient par les désordres qui y régnaient qu’un trop plausible prétexte aux déclamations anti-papistes des huguenots. Aussi, la nécessité d’une réforme radicale dans le clergé et surtout dans les établissements religieux se faisait-elle généralement sentir.


![]() ais ces noms de chanoine de Saint-Augustin ou de chanoine génovéfain offrent-ils à tous nos lecteurs une idée suffisamment nette ? L’oubli s’est fait bien vite sur les institutions de la vieille France, et quelques mots ne seront peut-être point déplacés ici au sujet de l’ordre de Saint-Augustin ou des chanoines réguliers, ordre qui constituait une des trois grandes divisions de l’état monastique ; - l’ordre de Saint-Benoît et les ordres mendiants, nom sous lequel nous comprenons tous ceux qui par leur règle ne pouvaient posséder de bénéfices, formaient les deux autres.
ais ces noms de chanoine de Saint-Augustin ou de chanoine génovéfain offrent-ils à tous nos lecteurs une idée suffisamment nette ? L’oubli s’est fait bien vite sur les institutions de la vieille France, et quelques mots ne seront peut-être point déplacés ici au sujet de l’ordre de Saint-Augustin ou des chanoines réguliers, ordre qui constituait une des trois grandes divisions de l’état monastique ; - l’ordre de Saint-Benoît et les ordres mendiants, nom sous lequel nous comprenons tous ceux qui par leur règle ne pouvaient posséder de bénéfices, formaient les deux autres.
![]() notre connaissance il n’existe pas aujourd’hui en France une seule maison de chanoines réguliers. Aussi sous ce nom de chanoines l’esprit se figure-t-il de suite ces bons vieux prêtres lassés des grands travaux du ministère, et qui, chargés de mérite, souvent de science, élite du clergé, forment, réunis en
chapitre, le conseil habituel de l’évêque, résident près de la cathédrale, viennent exactement au chœur chanter l’office canonial et touchent une modeste pension.
notre connaissance il n’existe pas aujourd’hui en France une seule maison de chanoines réguliers. Aussi sous ce nom de chanoines l’esprit se figure-t-il de suite ces bons vieux prêtres lassés des grands travaux du ministère, et qui, chargés de mérite, souvent de science, élite du clergé, forment, réunis en
chapitre, le conseil habituel de l’évêque, résident près de la cathédrale, viennent exactement au chœur chanter l’office canonial et touchent une modeste pension.
![]() r ces chanoines se distinguaient autrefois des autres, soit sous le simple nom de chanoines, soit, mais d’une manière impropre et seulement dans le langage de quelques auteurs, sous le nom de
chanoines séculiers. – Autres étaient les
chanoines réguliers
fort nombreux, en France avant la Révolution, et surtout au moyen-âge, - plusieurs in-quarto ont été écrits à leur sujet, mais si gros, si chargés de paragraphes, qu’il n’est point aisé d’y trouver vite ces notions nettes et précises si nécessaires aux esprits de notre époque encyclopédique. – L’origine du nom semble fort incertaine, celle de l’institution ne l’est pas moins. Les chanoines réguliers avaient bien la prétention de remonter jusqu’aux apôtres, toutefois c’est seulement vers le commencement du XIIe
siècle que les chanoines réguliers semble s’être constitués à l’état d’
ordre.
r ces chanoines se distinguaient autrefois des autres, soit sous le simple nom de chanoines, soit, mais d’une manière impropre et seulement dans le langage de quelques auteurs, sous le nom de
chanoines séculiers. – Autres étaient les
chanoines réguliers
fort nombreux, en France avant la Révolution, et surtout au moyen-âge, - plusieurs in-quarto ont été écrits à leur sujet, mais si gros, si chargés de paragraphes, qu’il n’est point aisé d’y trouver vite ces notions nettes et précises si nécessaires aux esprits de notre époque encyclopédique. – L’origine du nom semble fort incertaine, celle de l’institution ne l’est pas moins. Les chanoines réguliers avaient bien la prétention de remonter jusqu’aux apôtres, toutefois c’est seulement vers le commencement du XIIe
siècle que les chanoines réguliers semble s’être constitués à l’état d’
ordre.
|
|
Haut de la page |