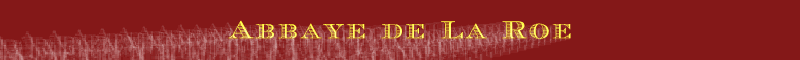


![]() es chanoines réguliers, ceci soit dit du reste en faisant abstraction de mille exceptions et différences selon les temps et les lieux, les chanoines réguliers vivaient généralement ensemble comme les moines, sous la conduite d’un abbé ou d’un prieur ; comme eux aussi ils se soumettaient à une règle et ne possédaient rien en propre, mais ils se distinguaient des ordres monachaux en ce que tous leurs membres étaient prêtres ou clercs. La clôture n’existait pas pour eux, et ils se livraient à tous les travaux extérieurs et publics du ministère, y compris l’administration des églises.
es chanoines réguliers, ceci soit dit du reste en faisant abstraction de mille exceptions et différences selon les temps et les lieux, les chanoines réguliers vivaient généralement ensemble comme les moines, sous la conduite d’un abbé ou d’un prieur ; comme eux aussi ils se soumettaient à une règle et ne possédaient rien en propre, mais ils se distinguaient des ordres monachaux en ce que tous leurs membres étaient prêtres ou clercs. La clôture n’existait pas pour eux, et ils se livraient à tous les travaux extérieurs et publics du ministère, y compris l’administration des églises.


![]() es chanoines réguliers se targuaient aussi, et il y a de cela déjà deux siècles, d’avoir fourni 2,767 cardinaux, 20,135 archevêques ou évêques, et plus de 100,000 abbés portant la mitre et la crosse. Mais le savant père Helyot, dans son histoire des ordres monastiques, pense qu’il faut en rabattre, puisqu’à cette époque toute la catholicité n’avait pas encore fourni ce nombre total de cardinaux.
es chanoines réguliers se targuaient aussi, et il y a de cela déjà deux siècles, d’avoir fourni 2,767 cardinaux, 20,135 archevêques ou évêques, et plus de 100,000 abbés portant la mitre et la crosse. Mais le savant père Helyot, dans son histoire des ordres monastiques, pense qu’il faut en rabattre, puisqu’à cette époque toute la catholicité n’avait pas encore fourni ce nombre total de cardinaux.
![]() uoiqu’il en soit de ces prétentions, leur exagération même prouve l’importance réelle de cet ordre de chanoines réguliers. Une même règle, dite de Saint-Augustin en dirigeait toutes les congrégations depuis l’an 1139, que le Pape Innocent II, dans le concile de Latran les y eut soumises. Ce n’est pas que Saint-Augustin eut précisément institué une règle. Mais ce fut lui qui à la vie et à la piété cléricale ajouta le premier la vie commune et la désappropriation des biens personnels. Il fut, du reste, facile de trouver les éléments d’une excellente règle de conduite monastique dans les œuvres de ce grand évêque. Son épître 109, adressée à des religieuses, en fut la principale base.
uoiqu’il en soit de ces prétentions, leur exagération même prouve l’importance réelle de cet ordre de chanoines réguliers. Une même règle, dite de Saint-Augustin en dirigeait toutes les congrégations depuis l’an 1139, que le Pape Innocent II, dans le concile de Latran les y eut soumises. Ce n’est pas que Saint-Augustin eut précisément institué une règle. Mais ce fut lui qui à la vie et à la piété cléricale ajouta le premier la vie commune et la désappropriation des biens personnels. Il fut, du reste, facile de trouver les éléments d’une excellente règle de conduite monastique dans les œuvres de ce grand évêque. Son épître 109, adressée à des religieuses, en fut la principale base.
![]() ’ordre canonique fleurit dès lors pendant plusieurs siècles et, séduits par la beauté de l’observance qui y régnait, beaucoup de ceux qui fondèrent des abbayes pendant les XIIe
et XIIIe
siècles y mirent des chanoines réguliers. – Vers le commencement du XIVe
siècle, un grand relâchement s’était cependant introduit dans la plupart de ces établissements, et le pape Benoît XII dressa, 1339, des constitutions en soixante-quatre articles qu’il voulut être suivies universellement. Mais autre est une réforme, autre une ordonnance de réforme. Ces dernières ne ressemblent le plus souvent qu’à ces remèdes
in extremis
auxquels recourent les médecins désespérés ; elles prouvent le mal, elles ne le guérissent pas. – Les soixante-quatre articles du pape restèrent à peu près à l’état de lettre morte et c’est au père Faure que l’ordre canonial dut réellement sa restauration.
’ordre canonique fleurit dès lors pendant plusieurs siècles et, séduits par la beauté de l’observance qui y régnait, beaucoup de ceux qui fondèrent des abbayes pendant les XIIe
et XIIIe
siècles y mirent des chanoines réguliers. – Vers le commencement du XIVe
siècle, un grand relâchement s’était cependant introduit dans la plupart de ces établissements, et le pape Benoît XII dressa, 1339, des constitutions en soixante-quatre articles qu’il voulut être suivies universellement. Mais autre est une réforme, autre une ordonnance de réforme. Ces dernières ne ressemblent le plus souvent qu’à ces remèdes
in extremis
auxquels recourent les médecins désespérés ; elles prouvent le mal, elles ne le guérissent pas. – Les soixante-quatre articles du pape restèrent à peu près à l’état de lettre morte et c’est au père Faure que l’ordre canonial dut réellement sa restauration.
![]() e saint homme né à Luciennes, près Paris, entra en 1614 à l’abbaye de Saint-Vincent de Senlis. Il s’aperçut bientôt avec tristesse du relâchement de la plupart de ses frères, mais la force de ses bons exemples et de ses exhortations ne tarda pas à les ramener pour la plupart, si bien que le gouvernement de la maison lui fut confié. Or il arriva que le cardinal de la Rochefoucauld, évêque de Senlis, et l’un des premiers admirateurs du père Faure fut nommé par le roi, en 1619, abbé de Sainte-Geneviève, pour rétablir la régularité dans cette célèbre abbaye alors fort corrompue. Il songea de suite au père Faure et le fit venir de Senlis comme l’ouvrier le plus propre à l’aider dans sa difficile mission. – Les efforts persévérants du saint prêtre furent couronnés du plus heureux succès, si bien que de Sainte-Geneviève la réforme se répandit dans la plupart des autres maisons de chanoines réguliers. C’était dès lors toute une nouvelle congrégation qui se fondait et le père Faure en fut élu général triennal. Honoré trois fois de cet honneur, il mourut le 4 novembre 1644, laissant une des sociétés religieuses qui, jusqu’au moment de la Révolution, fit le plus d’honneur à la France. Elle devint bientôt la plus nombreuse de toutes celles qui composaient l’ordre des chanoines réguliers et compta plus de cent monastères.
e saint homme né à Luciennes, près Paris, entra en 1614 à l’abbaye de Saint-Vincent de Senlis. Il s’aperçut bientôt avec tristesse du relâchement de la plupart de ses frères, mais la force de ses bons exemples et de ses exhortations ne tarda pas à les ramener pour la plupart, si bien que le gouvernement de la maison lui fut confié. Or il arriva que le cardinal de la Rochefoucauld, évêque de Senlis, et l’un des premiers admirateurs du père Faure fut nommé par le roi, en 1619, abbé de Sainte-Geneviève, pour rétablir la régularité dans cette célèbre abbaye alors fort corrompue. Il songea de suite au père Faure et le fit venir de Senlis comme l’ouvrier le plus propre à l’aider dans sa difficile mission. – Les efforts persévérants du saint prêtre furent couronnés du plus heureux succès, si bien que de Sainte-Geneviève la réforme se répandit dans la plupart des autres maisons de chanoines réguliers. C’était dès lors toute une nouvelle congrégation qui se fondait et le père Faure en fut élu général triennal. Honoré trois fois de cet honneur, il mourut le 4 novembre 1644, laissant une des sociétés religieuses qui, jusqu’au moment de la Révolution, fit le plus d’honneur à la France. Elle devint bientôt la plus nombreuse de toutes celles qui composaient l’ordre des chanoines réguliers et compta plus de cent monastères.
![]() u jour où les chanoines de
La Roe
eurent sérieusement admis la réforme partie de cette congrégation de France, vulgairement appelée de Sainte-Geneviève, ils se maintinrent dans une voie où nul reproche ne put désormais les atteindre ; et c’est ici le cas d’observer que, si à certaines époques de l’histoire du christianisme les ordres religieux ont mérité de graves censures, jamais ils n’avaient offert une ensemble aussi méritant qu’au moment de leur suppression brutale par la Révolution.
u jour où les chanoines de
La Roe
eurent sérieusement admis la réforme partie de cette congrégation de France, vulgairement appelée de Sainte-Geneviève, ils se maintinrent dans une voie où nul reproche ne put désormais les atteindre ; et c’est ici le cas d’observer que, si à certaines époques de l’histoire du christianisme les ordres religieux ont mérité de graves censures, jamais ils n’avaient offert une ensemble aussi méritant qu’au moment de leur suppression brutale par la Révolution.


![]() un kilomètre environ de l’abbaye, aux bords d’un bel étang, se voit encore le vieux château de Pelletrée ou Poiltrée, en latin
Pelletraia. Ce château près duquel Louis XI établit son camp lorsqu’il vint assiéger La Guerche, en 1472, appartenait au seigneur de Craon et existait, on a lieu de le croire, dès avant la fondation de la paroisse et de la communauté de Notre-Dame-des-Bois. Plusieurs fiefs en relevaient, et nous voyons entre autres, parmi ceux qui lui devaient hommage, les seigneurs de la cour de
La Roe
, famille plus connue sous le nom de
La Roe
, et qui selon Ménage, pourrait bien n’avoir été qu’une branche cadette de la première maison de Craon.
un kilomètre environ de l’abbaye, aux bords d’un bel étang, se voit encore le vieux château de Pelletrée ou Poiltrée, en latin
Pelletraia. Ce château près duquel Louis XI établit son camp lorsqu’il vint assiéger La Guerche, en 1472, appartenait au seigneur de Craon et existait, on a lieu de le croire, dès avant la fondation de la paroisse et de la communauté de Notre-Dame-des-Bois. Plusieurs fiefs en relevaient, et nous voyons entre autres, parmi ceux qui lui devaient hommage, les seigneurs de la cour de
La Roe
, famille plus connue sous le nom de
La Roe
, et qui selon Ménage, pourrait bien n’avoir été qu’une branche cadette de la première maison de Craon.
![]() ette famille qui figure dès les premières années du XIIe
siècle, s’était fort répandue en Anjou. Du moins l’histoire généalogique des familles de cette province nous montre fréquemment le nom de
La Roe
surtout au cours de XVe
et XVIe
siècles. Mais tous ceux qui le portaient avaient-ils une commune origine ? Question difficile, peut-être insoluble, et en tout cas d’un médiocre intérêt. Aucun n’a joué un rôle considérable. Si mêlés dans l’histoire d’illustres maisons, ils y comblent quelques lacunes de filiation et y servent comme de points d’union, - exposés isolément aux attentions de l’esprit, ils se dérobent vite et s’évanouissent comme ombres fugitives auxquelles nulle pensée du cerveau, nulle affection du cœur ne saurait s’attacher. Nous ferons cependant une exception en faveur d’une humble religieuse,
Marguerite de La Roë, qui vers le commencement du XVIe
siècle (1526), fonda à Laval un couvent d’
Urbanistes
ou sœurs suivant la règle de Sainte-Claire, mitigée par le pape Urbain IV, en 1263. – Elle habitent une maison nommée Patience et étaient connues sous le nom de dames de Patience. Cette maison n’existe plus – on s’y réunissait pour jeûner et prier – quel fanatisme ! aussi la Révolution y mit le holà !
ette famille qui figure dès les premières années du XIIe
siècle, s’était fort répandue en Anjou. Du moins l’histoire généalogique des familles de cette province nous montre fréquemment le nom de
La Roe
surtout au cours de XVe
et XVIe
siècles. Mais tous ceux qui le portaient avaient-ils une commune origine ? Question difficile, peut-être insoluble, et en tout cas d’un médiocre intérêt. Aucun n’a joué un rôle considérable. Si mêlés dans l’histoire d’illustres maisons, ils y comblent quelques lacunes de filiation et y servent comme de points d’union, - exposés isolément aux attentions de l’esprit, ils se dérobent vite et s’évanouissent comme ombres fugitives auxquelles nulle pensée du cerveau, nulle affection du cœur ne saurait s’attacher. Nous ferons cependant une exception en faveur d’une humble religieuse,
Marguerite de La Roë, qui vers le commencement du XVIe
siècle (1526), fonda à Laval un couvent d’
Urbanistes
ou sœurs suivant la règle de Sainte-Claire, mitigée par le pape Urbain IV, en 1263. – Elle habitent une maison nommée Patience et étaient connues sous le nom de dames de Patience. Cette maison n’existe plus – on s’y réunissait pour jeûner et prier – quel fanatisme ! aussi la Révolution y mit le holà !
par De Bodard de la Jacopière et le Baron de Wismes
|
|
Haut de la page |